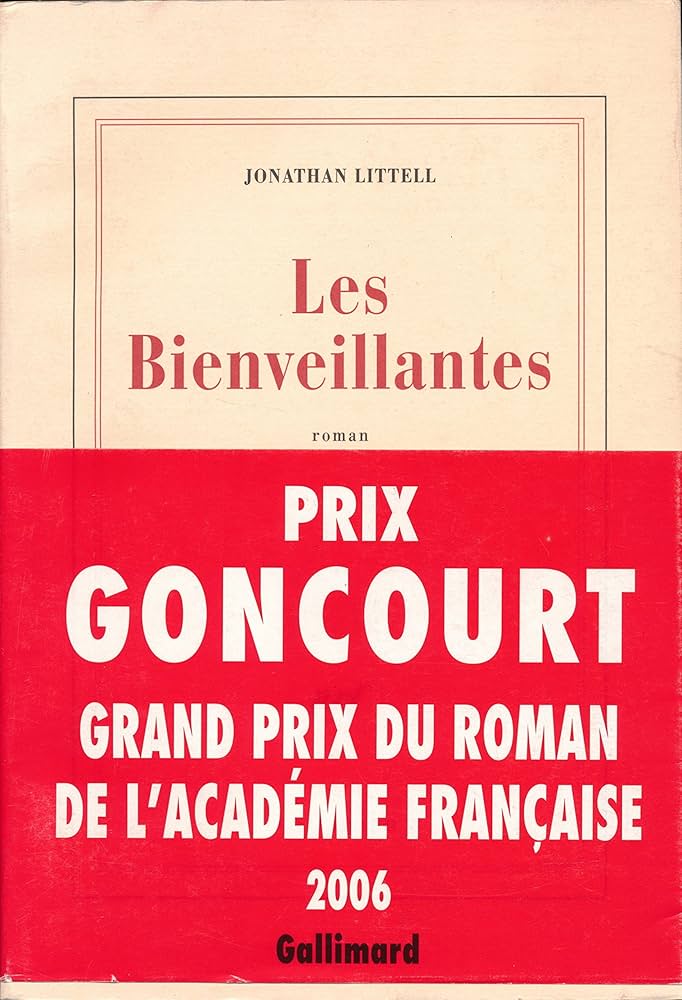Les Bienveillantes est un roman-monstre : 900 pages, près de 500 000 mots, un bloc massif qui cherche autant à éprouver le lecteur qu’à le captiver. Jonathan Littell a pris un pari audacieux : proposer une expérience de lecture intense, parfois pénible, parfois fascinante, toujours marquante. Ennuyer, agacer, révolter, instruire — le roman assume tout ça, et c’est précisément ce qui en fait un objet littéraire hors norme.
L’auteur a consacré cinq années de travail acharné à ce livre, presque jour et nuit. Ses recherches, d’une ampleur impressionnante, ont été saluées par les historiens, à une exception près : la trajectoire du narrateur, un Franco-Allemand qui gravit les échelons de la SS et traverse presque tous les lieux emblématiques du crime nazi, est historiquement improbable. Mais cette invraisemblance sert avant tout la fresque et son ambition totalisante.
Le récit adopte le point de vue d’un officier SS qui tente de justifier l’horreur. Littell pousse le lecteur à rester à l’intérieur d’une conscience glaçante, ce qui rend la lecture aussi dérangeante qu’instructive. Aspect peu commenté mais central : le roman peut aussi être lu comme une œuvre LGBTQIA+, à travers un protagoniste en tension permanente entre homosexualité, bisexualité et aromantisme.
C’est un véritable défi de lecture, idéal pour celles et ceux qui aiment les romans historiques exigeants et qui n’ont pas peur d’être mis face à un personnage absolument dérangeant.
Si certaines longueurs m’ont parfois fait accélérer le rythme, je ne me suis pourtant jamais assez ennuyé pour abandonner — et j’ai finalement tourné la dernière page de ce pavé d’1,2 kg.