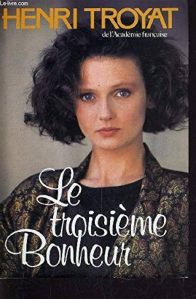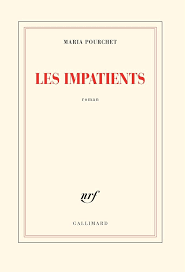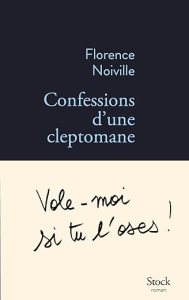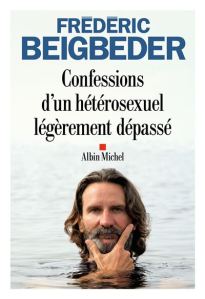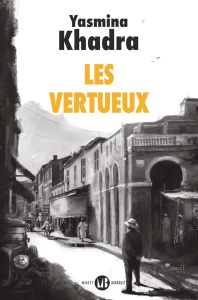Alléché par ce succès inattendu, vendu comme l’histoire d’un petit prof d’EPS et son chien, j’étais curieux, surtout que j’ai peur des chiens (de leurs maîtres plus précisément) et je suis un dingue de chat.
La première question que je me suis posée : les fous de chien vont-ils aimer Son odeur après la pluie ? La réponse est oui, à l’instar de Jean-Paul Dubois qui offre une excellente préface (D’habitude, je ne le lis jamais, elles m’ennuient). 7,5 millions de chiens en France, sans compter le monde francophone, ce livre va être un cadeau idéal : « Prends-lui ça, la couverture avec le chien, j’ai vu un truc sur BFM et elle nous gonfle tellement avec son clébard ! ». Je vais moi-même l’offrir à une amie vétérinaire pour connaître son opinion.
Je pense que Cédric Sapin-Dufour décrit avec justesse l’amour entre un homme et son chien. Il les aime tellement qu’il en adopte deux autres, des grands. Il trouve une compagne qui partage sa passion. Ils sont passionnés de chien et pour eux, ce ne sont même pas des sacrifices. Beaucoup s’identifieront à eux.
Et les autres ? Je suis dubitatif.
D’abord, si j’apprécie quand un auteur chercher à tourner un minimum ses phrases, entreprend un effort ; ici, cela en devient parfois grotesque. Surtout au début du livre, Cédric Sapin-Dufour ne savait pas comment débuter, alors qu’il avait bien sûr la fin en tête, chaude et tragique. Pour rendre intéressantes des banalités, il tente un style littéraire confus :
Il est ainsi des pics de l’existence qui invitent les géographies de l’enfance, nostalgie d’un temps où les rêves faisaient foi, évidents, irrévocables, insensibles aux monitions des prophètes de pacotille, experts en lendemain malaisés, ceux qu’on appelait les vieux.
Il cherche le bon mot, comme « cénotaphe », mais un cénotaphe ne contient pas le corps du défunt, en Inde, j’en ai visité et nos monuments aux morts en sont.
De plus, l’auteur m’a paru peu sympathique. Attention, personnalité de l’auteur m’indiffère dans un livre, sauf et c’est le cas ici, quand c’est une autobiographie. Cédric Sapin-Defour et Ubac le bouvier bernois sont les personnages principaux. En résumant son récit, si vous n’aimez pas les chiens, vous êtes des imbéciles. Et ce monsieur ne peut pas s’empêcher, surtout au début, il ne sait pas quoi écrire, de lancer des réflexions.
Finalement, ce sentimentalisme ne fait de mal à personne sauf à l’humanité tout entière négligeant la force souveraine des uns, niant l’arrogance des autres, oubliant qu’une poignée de milliards d’hommes mériteraient d’être choyés de la sorte.
Là, il fait la morale à ceux qui achètent des gadgets pour leurs chiens. Lui, il a payé 900 euros le sien. Chacun est libre de dépenser son argent comme il veut et devrait éviter de mettre son nez dans les dépenses des autres.
Enfin, je n’ai pas été touché. Je pensais réveiller le petit enfant qui pleurait devant la mort d’un animal. Raté ici, tant l’amont fut prétentieux et moralisateur.
En conclusion, je suis content d’avoir eu la curiosité de lire Son odeur après la pluie, sans en être la cible. Je le note sévèrement, peu enclin à valoriser leur quotidien. En revanche, je comprends son succès et je ne nie pas son intérêt pour les cynophiles.